Entretien avec Marie-Cécile Fauvin, lauréate du Prix de la traduction Inalco / Vo-Vf 2024
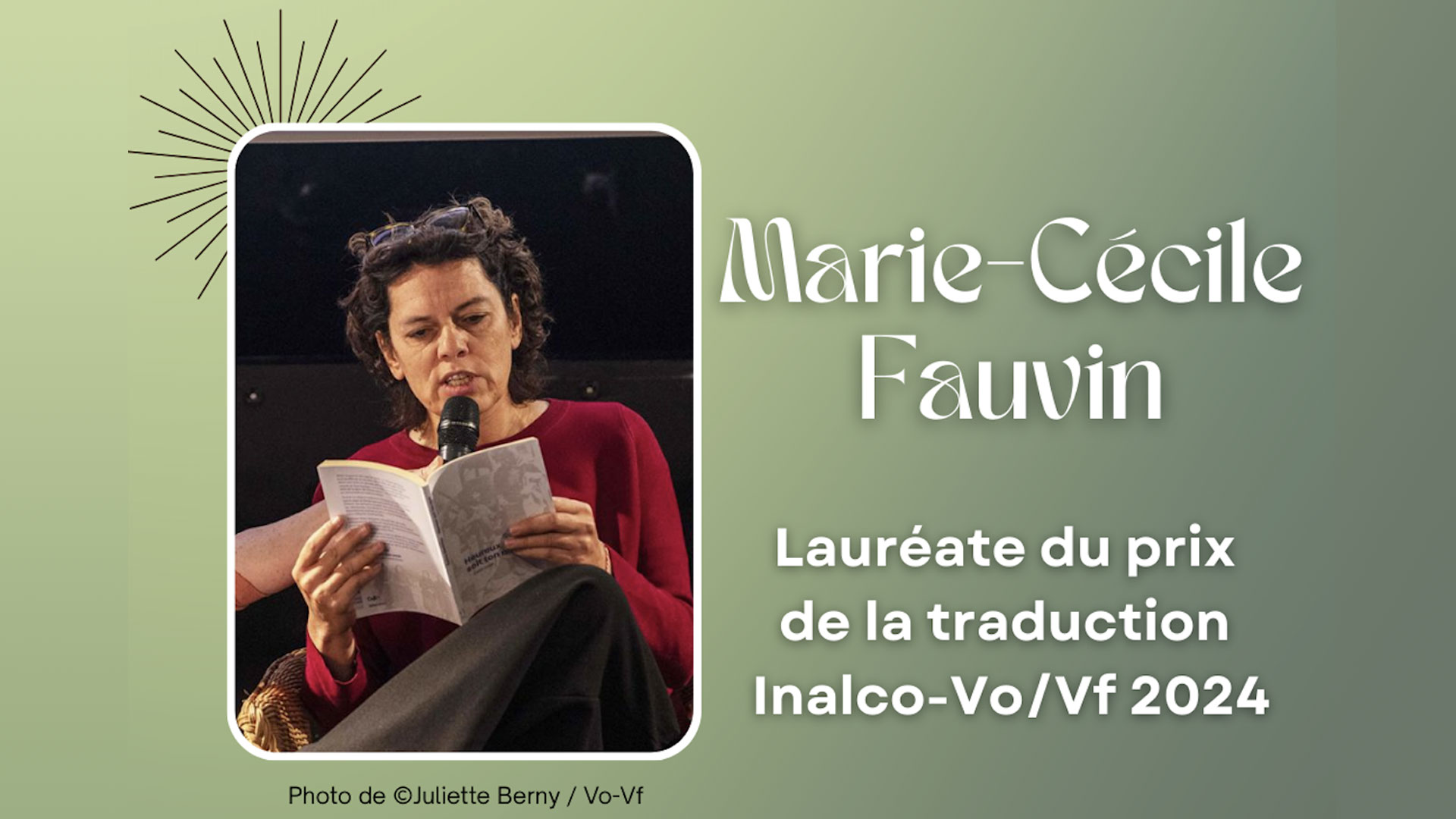
Avant d’être traductrice, Marie-Cécile Fauvin suit des études de lettres classiques, spécialité grec ancien. Durant ses études, elle a l’occasion de partir en mobilité à l’étranger. Pour son ERASMUS, son choix se porte sur la Grèce. C’est là-bas qu’elle apprend le grec moderne. Après ses études, elle se dirige vers l’enseignement, mais c’est une déception. Elle se tourne alors vers le domaine de l’agriculture mais change de nouveau rapidement pour se reconvertir en tant que correctrice d’édition. Elle finit par obtenir une bourse pour suivre une formation de traduction à Athènes en 2014. C’est sa première expérience en traduction et elle est épanouie dans son travail.
Aujourd’hui, elle exerce en tant que traductrice et correctrice pour des maisons d’édition.
Notre équipe d’étudiantes de l’ISIT lui a alors posé quelques questions sur son parcours de traductrice, qui l’a amenée à remporter le Prix de la traduction Inalco / Vo-Vf.
Traduisez-vous du grec ancien ?
« Je ne traduis pas du tout de grec ancien. J’ai traduit des textes en grec ancien uniquement durant mes études, en thème et en version. J’ai toujours traduit le grec ancien à l’université mais jamais de manière professionnelle. »
Comment avez-vous connu le livre Heureux soit ton nom écrit par Sotiris Dimitriou ?
« C’est moi qui ai proposé le livre. Je l’ai découvert au cours de la formation que j’ai suivie à Athènes. Tous les 15 jours, les professeurs nous présentaient un auteur et nous devions lire une de ses œuvres. J’ai donc lu Heureux soit ton nom. J’ai tout de suite été emballée et bouleversée par l’auteur lui-même, par sa façon de parler de ses œuvres et puis par le texte.
Effectivement, je ne me suis pas attaquée tout de suite à la traduction de Heureux soit ton nom qui est écrit dans une langue partiellement dialectale. J’ai commencé par des nouvelles qu’il a écrites dans un grec beaucoup plus courant. C’est un recueil de 20 nouvelles qui est paru aux Editions Desmos en 2018 et qui s’intitule Été dans les corps, été dans les cœurs.
J’aimais bien l’idée de continuer avec cet auteur mais je ne savais pas trop comment m’attaquer à Heureux soit ton nom car je ne savais pas comment résoudre la question et la traduction du dialecte. Finalement j’ai commencé par un autre roman : Dieu leur dit paru aussi chez Quidam. Concernant Heureux soit ton nom, j’ai d’abord traduit un extrait puis je me suis attaquée à la traduction complète. Je l’ai ensuite proposé à un éditeur pendant la pandémie et celui-ci a accepté très rapidement.
C’est vraiment moi qui ai choisi le roman. Aucun éditeur français ne me l’a proposé. En réalité, c’est assez rare que l’on me fasse des commandes. »
Votre relation avec l’auteur se retranscrit-elle dans votre traduction ?
« L’auteur est très collaboratif. Il accepte de répondre à toutes mes questions. Plus je travaille un texte, plus j’approfondis, et plus il y a des subtilités que j’ai besoin de résoudre. Grâce à sa patience, je pense que j’ai atteint un niveau de compréhension maximale du texte original. Le plus souvent, ce ne sont pas des questions de langue mais plutôt des questions de culture. Par exemple, en 1946 dans le roman, un groupe de femmes part pour sauver le village de la famine pour mendier et faire du troc dans les villages avoisinants. Elles se mettent à chanter et danser au bord de la mer et le texte disait « on se sentait libre de le faire parce qu’on était loin du village ». C’était quelque chose que je n’avais pas compris. Je lui ai donc posé la question. Il m’a expliqué qu’en Grèce il n’est pas autorisé de danser comme ça, n’importe comment. C’est très protocolaire. La danse se fait dans le village, aux côtés de sa famille. C’est très codifié en fait. Et c’est pourquoi je ne comprenais pas cette scène. Je n’arrivais pas à percevoir la position de la femme dans une société traditionnelle.
Heureusement qu’il était là et qu’il répondait à mes questions car il n’y a pas de dictionnaire de l’Epirote. Mon dictionnaire c’était lui finalement. Lui et sa mère aussi. Parfois il avait des doutes sur un mot ou une tournure de phrase, alors il appelait sa mère qui avait presque 100 ans à cette époque.
Donc je pense qu’en effet notre relation se ressent à travers la traduction et le roman lui-même. »
Avez-vous pu visiter la région où se passe le roman Heureux soit ton nom ?
« Jusqu’à l’été dernier je n’avais jamais mis les pieds en Epire. J’avais très envie d’y aller bien sûr mais je n’ai jamais fait le voyage. L’été dernier j’y ai donc passé trois jours et j’ai été enchantée par notamment les paysages, les villages, la montagne. Ça ne m’a pas réellement aidée puisque les traductions étaient déjà faites. Cependant c’est tout de même une région que j’ai envie de découvrir plus en profondeur. »
Avez-vous proposé à des maisons d’édition tous les textes que vous avez traduits ?
« Pas totalement, en réalité j’exagère un petit peu lorsque je dis qu’on ne me propose jamais de texte. On m’a proposé trois fois des textes et au total 9 de mes traductions ont été publiées. Les trois textes qui m’ont été proposés sont 2 romans de Christos Chomenidis et puis des poèmes de Georges Séféris. Sinon, c’est moi qui propose. Les commandes ne pleuvent pas malheureusement. Le bon côté des choses : je traduis des choses qui me plaisent vraiment et qui m’ont vraiment convaincues. Cependant, chaque démarche est plus laborieuse car chaque fois il faut monter un dossier de présentation, traduire une vingtaine de pages, rédiger une présentation convaincante, et tout cela prend beaucoup de temps. Il faut ensuite l’envoyer à des éditeurs et puis après il faut encore attendre au moins 6 mois pour avoir enfin une réponse. C’est lassant parce qu’on ne sait jamais si cela va aboutir. »
Y a-t-il beaucoup de demandes sur des traductions de textes grecs vers le français de manière générale ?
« Il y a un intérêt. La France est réputée pour traduire des langues étrangères y compris des langues dites « petites ». J’ai quand même réussi à trouver un port d’attache pour un certain nombre de textes grecs comme ceux de Sotiris Dimitriou pour lesquels au départ ce n’était pas vraiment gagné. Il faut donner beaucoup d’efforts. Il faut leur trouver une place. »
Comment vous est venue l’idée de remplacer le dialecte grec par du patois auvergnat et comment avez-vous réussi à trouver un équilibre entre traduire les expressions du grec épirote et les conserver sans que cela ne dénature la traduction ?
« Longtemps, je n’ai pas su quoi faire avec ce grec épirote. J’ai lu ce qu’avaient écrit les autres traducteurs dans d’autres langues. Je suis allée voir surtout du côté de la traduction italienne. Je suis tombée sur des traductions de Dominique Vittoz qui est connue pour avoir traduit en parler Lyonnais. Je me suis mise en tête de faire la même chose. J’allais passer mes vacances dans l’est de l’Auvergne, c’est pour cette raison que j’ai choisi le patois auvergnat. Je ne parlais pas le patois parce que le patois en Auvergne c’est vraiment une autre langue. C’est une variété de l’occitan. J’entendais les paysans parler entre eux en patois. J’entendais surtout des tournures et des expressions qui avaient l’air françaises mais qui en fait étaient l’empreinte du patois dans la langue française. Par exemple, une paysanne qui parlait de son voisin mort disait « Quand Félix est mort ça m’a su mal » qui veut dire « J’en ai eu gros sur le cœur ». C’est comme « Ça m’a su bien » qui veut dire l’inverse : « Ça m’a réjoui ». J’ai eu envie de les utiliser. Evidemment, comme j’avais une connaissance du parler assez limitée, j’ai voulu approfondir donc j’ai lu des livres d’auteurs auvergnats, notamment Henri Pourrat et Lucien Gachon. J’ai trouvé chez eux le parler rural qu’il me fallait, et une langue avec des tournures étranges. Il me fallait une forme d’étrangeté pour ne pas aplanir le texte et ne pas le traduire en français standard. Finalement, ce n’est pas seulement le régionalisme qui m’a posé problème. C’est un mélange de régionalisme et de langue rurale. C’était un double défi. Je vous assure qu’une langue rurale est très difficile à trouver dans la littérature française.
Je n’ai pas fait une œuvre muséographique. Mon but n’était pas de sauver les reliquats du patois auvergnat. Mon but était de rendre la poésie et la vivacité de la langue et surtout d’écrire dans une langue non standard. C’était compliqué mais tout à fait passionnant. »
Côtoyez-vous d’autres traducteurs du grec ?
« Oui, j’ai quelques amis traducteurs. On échange un peu. On ne relit pas nos travaux respectifs mais on parle des problèmes qu’on rencontre et on partage nos expériences. C’est précieux. On échange aussi des contacts. On se rend des services. »